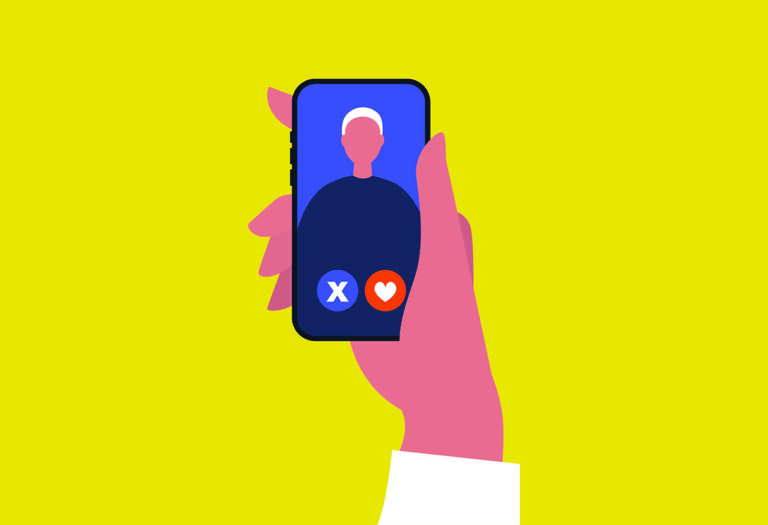Je n’avais jamais rencontré Ian en personne ; nous avons matché sur une application de rencontre en janvier, une semaine avant qu’il ne s’envole pour la Chine pour enseigner les cultural studies dans une université à Hong Kong. Nous avons continué à nous envoyer des messages, et c’est Ian qui, le jour de la Saint-Valentin, m’a fait découvrir le terme de distanciation sociale. Son école venait de passer aux cours en ligne, au moment où les magasins et les restaurants commençaient à fermer, et il se sentait seul. Il m’a décrit la vie à Hong Kong comme une sorte de super futur, dans lequel le tissu social s’était délité et où les citoyens vivaient sur une ligne de faille. Il déplorait l’impossibilité de se faire de nouveaux amis ou de faire des rencontres à l’ancienne ; il m’a envoyé un article du South China Morning Post sur la façon dont nous dépérissons sans contact physique. Il semblait relativement joyeux, cependant, et il en était venu à mener une vie d’ascète, courant vingt kilomètres par jour à travers les collines verdoyantes de Hong Kong et maîtrisant l’équilibre de sa posture en grand écart sur un bras grâce aux enseignements de Fiji McAlpine, son professeur de yoga virtuel.
À l’époque, le virus semblait, du moins à mes yeux, être une menace seulement pour la Chine. La distanciation sociale ferait un bon titre de roman, ai-je plaisanté, sans jamais imaginer que les Américains feraient de même quelques semaines plus tard, que l’expression rejoindrait bientôt tant d’autres — la propagation communautaire, une abondance de prudence, l’aplatissement de la courbe. Mais ensuite, l’événement littéraire pour lequel j’avais conduit ma mère à la maison d’été du Rhode Island a été annulé, en même temps qu’une grande partie de la vie à New York, et alors que j’étais habituée, et même m’épanouissais dans de longues séjours en solitaire — l’hiver précédent, j’avais choisi de m’isoler pendant soixante jours, une existence qui se révélait presque identique de celle que je menais désormais — je me suis rendu compte que cette fois-ci, je n’avais pas le choix, ce qui a donné lieu à une solitude intense et paniquée. Le coronavirus et l’isolement qu’il imposait, associés à l’incertitude quant à l’avenir, quant à la durée d’un tel retrait radical, constituaient la preuve la plus fragrante que, quatre ans et demi après mon divorce, j’étais encore fondamentalement seule.

Soyons clairs, de mille et une manières, j’ai été plus chanceuse que la plupart. En tant qu’écrivain et professeur particulier dans la trentaine, je n’avais pas à me soucier de ma santé ou de mes finances — comme mon patron l’avait dit dans un courriel, les cours en ligne étaient l’un des rares secteurs en croissance. Ma mère de soixante-quatorze ans s’isolait dans son Australie natale, un pays qui semblait se porter relativement bien, et j’avais accès à sa maison au bord de l’eau et à des promenades quotidiennes le long de la rivière. Alors que je me gavais d’infos en continu sur le virus, passant plus de cinq heures par jour à rafraîchir les flux en direct du Washington Post et du New York Times, je m’inquiétais pour les millions de travailleurs qui avaient perdu leur emploi, pour les 750 000 élèves des écoles publiques de New York qui n’avaient pas assez à manger, pour le fait qu’un jour prochain, nos soignants devraient bientôt trier les patients dans nos hôpitaux. Mais la conscience de sa propre bonne fortune ne suffit pas à tenir la solitude à distance, et ce fut une douleur d’un genre nouveau que de parler à mes amis pendant mes promenades sur la rivière et de réaliser que, alors que nous étions tous perdus et effrayés, eux, ils avaient au moins accès à un ou deux autres êtres humains contre qui ils pouvaient se blottir la nuit.
Je ne pouvais pas supporter l’assaut des réseaux sociaux sur toutes les adorables activités de quarantaine qu’apparemment, tous ceux que je connaissais entreprenaient avec leurs partenaires et leurs enfants : faire des raviolis maison, reconstituer des scènes de tableaux célèbres, maîtriser l’art du kintsugi. Je me suis sentie idiote quand j’ai envoyé des invitations de plus en plus pressantes à mes amis en couple pour qu’ils me rejoignent au bord de la mer, et que j’ai reçu pour toute réponse des SMS gentils, mais peu engageants. J’ai pris un plaisir morbide à lire des articles sur la montée en flèche des taux de divorce en Chine, à recevoir des dépêches de plus en plus désespérées de parents échouant à faire l’école à la maison. J’aurais aimé avoir un enfant à élever, pourtant : je m’étais donné jusqu’à quarante ans pour retomber amoureuse et ainsi repousser l’éventualité d’être mère célibataire, et c’était desespérant de penser que les dix-huit mois restants étaient désormais réduits à peau de chagrin. Le pire, c’est qu’un de mes deux chats les plus âgés, Oscar, perdait rapidement du poids ; le vétérinaire soupçonnait un lymphome intestinal, mais le technicien de laboratoire était chez lui avec des symptômes du corona, et personne au bureau ne pouvait lui faire passer une échographie.
J’ai écrit à Ian le 3e jour. « Je me sens seule ! » « (CALIN) », m’a-t-il répondu — ce qui m’a fait plus de bien qu’on ne pourrait l’imaginer — puis, « Je te comprends, l’isolement, ça craint ». Lui-même en était au 60e jour, et il m’a envoyé un selfie de sa barbe de quarantaine, épaisse et cuivrée, prise depuis son appartement immaculé, rempli de produits de soins visage et corps Esope et de meubles laqués rouges. Il a été réconforté d’apprendre que j’aimais son nouveau look — les Hongkongais n’avaient pas été très enthousiastes, a-t-il dit, attendant un style plus banquier de la part de leurs expatriés. Il m’a également envoyé, bien avant que ce soit en vogue, une playlist “Survivre au COVID”, avec des chansons comme « Let’s Move to the Country » et « No More Airplanes », qui m’ont fait rire. Dans des circonstances normales, les huit mille kilomètres qui nous séparent auraient pu sembler être une distance trop importante, mais au fil des jours, nous nous sommes écrits de plus en plus. Il m’a tout raconté sur sa famille — la personne qui fabriquait des tonneaux sur le Mayflower était un de ses ancêtres direct — et sur ses années à l’étranger, à Istanbul et à Dublin ; je lui ai parlé de mes écrits et de mon chat malade. Il m’a souvent contacté pendant son petit déjeuner habituel, café et amandes, et il a fini par me proposer de faire un de ces « trucs bizarres de premier rencard en FaceTime ». J’ai accepté, en précisant bien que d’ordinaire, jamais je ne ferais une chose pareille, et nous avons établi un plan pour le vendredi suivant — mon 14e jour et son 71e jour. J’avais l’impression que Ian, dans la vraie vie, était trop entier, trop nomade pour moi, mais j’avais vraiment hâte.
Contrairement à Ian, j’avais adopté une réponse résolument non ascétique à l’isolement. Oui, je m’étais inscrite à un essai gratuit de quinze jours de YogaGlo et j’avais fait griller huit kilos de légumes, mais je dormais aussi jusqu’à dix heures, je développais une habitude d’achat en ligne coûteuse et je me frayais un chemin dans le congélateur de ma mère à une vitesse alarmante, décongelant un par un des mets — un jambon au miel, une tarte aux myrtilles, des pêches mijotées et du poisson blanc fumé — que j’avais jugés trop bizarres ou trop mauvais pour la santé un mois auparavant. Je buvais aussi avec abandon, attendant avec un peu trop d’impatience mon gin tonic du soir, que je buvais sous une couverture sur le pont au coucher du soleil et que je poursuivais le plus souvent avec une demi-bouteille de vin. (Ian « ne buvait plus vraiment », m’a-t-il dit, mais il m’avait proposé de partager ses spiritueux aromatiques sans alcool pour notre rendez-vous). Lorsque le soleil s’est couché sous les arbres, de l’autre côté de l’eau, et que j’ai pris connaissance des dernières nouvelles – « l’Italie dépasse le nombre de morts en Chine, devenant ainsi le premier pays de la liste mondiale » ; « New York dit aux travailleurs non essentiels de rester à la maison » — je me suis sentie indifférente et brumeuse, et intriguée par la perspective d’envoyer un SMS à l’un des nombreux hommes de ma vie avec qui je m’étais fixé un temps. En effet, pour les célibataire parmi nous, l’apparition du coronavirus a été comme le silence soudain dans un jeu de chaises musicales ; en un instant, les personnes avec lesquelles nous sortions de temps en temps — avec qui nous pensions déjà être incompatibles, et sans doute vice versa — étaient celles avec lesquelles nous nous retrouvions coincés.

Prenez par exemple Paul, un peintre avec lequel j’ai correspondu pour la première fois en 2016 et dont je change le nom pour des raisons évidentes, comme celui d’autres dans ce récit. À l’époque, il n’avait pas donné suite à un mais deux rencards, d’abord parce qu’il avait perdu mon numéro en « reformatant son téléphone », et ensuite parce qu’il avait « écrasé son téléphone dans l’atelier ».
« Ouah ! Tu as vraiment beaucoup de problèmes de téléphone ! » lui avais-je écrit. Un message auquel il a répondu quatre ans plus tard lorsque nous avons encore matché sur Bumble. « C’est un personnage controversé, c’est sûr », m’a dit mon ami qui l’a connu dans le monde de l’art. « Fuyant me vient à l’esprit ? Mais il a toujours été très gentil avec moi. » Plus tard, une autre connaissance mutuelle le décrivit comme un « pique-assiette ».
Paul et moi nous sommes vus deux fois avant que je ne décampe contre mon gré dans le Rhode Island, des rencontres dominées par les discussions sur Walter Benjamin et le postcolonialisme ; de temps en temps, j’ai essayé de poser des questions sur sa mère ou son enfance, mais la conversation tournait toujours autour de Grandes Idées. Il ressemblait à une très belle lesbienne, au point que je me suis préparée à une surprise lorsque nous avons retiré nos vêtements pour la première fois, et il était très sérieux et égocentrique, m’envoyant par trois fois des liens non sollicités vers un court métrage qu’il avait réalisé et me demandant mon avis. Quand je l’ai enfin regardé, en écrivant ce que je pensais être une réponse bienveillante, il n’a pas écrit pendant quatre jours. (Un jour, quand tout cela sera derrière moi, j’écrirai un hommage à Rebecca Solnit intitulé « Les hommes m’envoient leurs œuvres »).
Malgré cela, j’étais follement attirée par lui et j’ai été déçue lorsque l’université du Rhode Island où il enseignait a, comme on pouvait s’y attendre, renvoyé ses étudiants chez eux et qu’il m’a envoyé un SMS pour me dire qu’il ne venait plus pour le week-end. La semaine suivante, il m’a contacté presque tous les jours m’envoyant d’autres œuvres pour lesquels le féliciter – « Nous avons commencé un sound cloud ! » – et des liens vers des articles que j’avais déjà lus car, là encore, je consommais cinq heures de reportages par jour. Sa réaction au virus à la paranoïa ; il demandait sans cesse pourquoi Facebook supprimait les messages COVID-19 de tout le monde, pourquoi les médias ne rendaient pas compte des modèles épidémiologiques les plus sombres, pourquoi une armée de chars se dirigeait vers l’ouest de la ville sur la route ferroviaire de Long Island. Toujours assis sur le pont, je sirotais mon cocktail et je répondais par SMS aux encouragements et aux validations. En regardant l’eau, en respirant les roses et les jaunes du ciel nocturne, il était presque impossible de croire que nous étions en guerre. Le huitième jour, animé par les fantasmes d’un rendez-vous galant, je l’ai invité à venir s’isoler avec moi. Il m’a écrit : « Merci ! Je pourrais te prendre au mot quand les villes s’écrouleront. »
D’autres soirs, je contactais Steven, une créature douce et hirsute avec qui j’étais sans doute encore moins compatible que Paul. L’été précédent, pour notre premier et unique rendez-vous, il m’avait demandé de le rencontrer dans une caserne de pompiers abandonnée qu’il était en train de transformer en bar et auberge — son emplacement était si suspect que ma mère, qui m’y avait conduit, s’était arrêtée sur un parking de McDonald’s et nous avait surveillé de loin. En buvant des bières dans la cuisine commune, il m’a semblé instable et fauché. J’ai donc été surprise lorsqu’il m’a ensuite emmené dîner dans une Lexus enfumée et a mentionné un récent voyage aux Galápagos ainsi qu’une fondation caritative privée ; une recherche rapide sur Google dans la salle de bain a révélé que sa famille valait 14 milliards de dollars. Avant la fin de la nuit, il m’a fait découvrir la boîte de nuit qu’il possédait, l’existence de la cocaïne liquide, son chat tigré bien-aimé et le loft magique et labyrinthique dans lequel il vivait, dont une aile entière était consacrée à des expériences de S&M — à deux heures du matin, j’étais sur sa balançoire sexuelle, nue et couchée, pendant que tout habillé, il fixait des ventouses sur mes deux mamelons.
À l’époque, j’avais décidé que Steven était un peu trop effrayant à mon goût, mais sur un coup de tête, je l’avais invité à un événement littéraire, désormais annulée, et nous avions depuis commencé à nous voir de loin. Un soir, il m’a envoyé un chat en pleurs en emoji, puis il s’est excusé – il était de mauvaise humeur, disait-il, car il venait de quitter ses parents dans le Connecticut ; il s’était ennuyé tout le week-end, mais il s’est mis à brailler quand est venu le moment de lui dire au revoir. Maintenant, il s’ennuyait juste à la maison, car l’État avait fermé son club et le bar de l’auberge. Son plan était de boire pour supporter l’isolement, dit-il, tout en trouvant du temps pour améliorer sa maison et travailler les métaux dans son atelier. Quand je lui ai dit que j’étais impressionné qu’il arrive à travailler et que j’avais du mal à me concentrer, il était plein de bonnes suggestions. « Peut-être qu’un petit reset de ton esprit via le LSD pourrait t’inspirer », m’a-t-il proposé. « Ou une stimulation sensuelle relaxante. »
Puis, le 10e jour, ma meilleure amie, Helen, qui avait des problèmes de santé chroniques et se plaignait d’un mal de gorge, a été admise dans un hôpital de New York parce qu’elle ne pouvait pas respirer. Je marchais dans les bois quand j’ai appris la nouvelle, et je me souviens du frisson qui a parcouru mon corps. C’était la première fois que j’étais capable de concevoir la maladie qui m’obsédait depuis des semaines et la première fois aussi que je me rendais compte que nous serions — chacun d’entre nous — intimement touchés par elle d’une manière ou d’une autre. J’ai essayé pendant un moment d’imaginer un monde dans lequel Helen n’existait plus, dans lequel je ne pouvais plus l’appeler pour lui dire bonjour, dans lequel ses deux fils grandiraient sans leur mère, et ensuite j’ai essayé de multiplier cette désolation par 14 443, ce qui était le nombre actuel de morts dans le monde, même si bien sûr j’ai échoué — nos esprits ne sont pas faits pour de si grands nombres.
Ensuite, je suis allée à l’épicerie pour la première fois en deux semaines, regardant avec fascination les bouteilles de désinfectant dans le vestibule, les rayons dévalisés, les caissiers portant des masques et des gants en plastique. Ce semestre-là, je travaillais sur l’Histoire Américaine avec une lycéenne, la guidant à travers les dévastations de la guerre de Sécession et de la Grande Dépression, et il était surprenant de reconnaître dans cette scène de supermarché légèrement apocalyptique quelque chose d’approchant des images en noir et blanc qui ornaient son manuel. Je n’avais jamais eu l’impression de faire partie de l’Histoire à ce point, ni compris avec autant d’acuité à quel point il y avait peu de choses qui nous séparaient des hommes et des femmes du passé, à quel point nous n’avions toujours été que des gens. Je souriais aux autres clients alors que nous faisions tourner nos chariots en rond d’un mètre cinquante — « la valse des chariots », comme l’appelle un ami de ma mère — et je ressentais à leur égard un étrange mélange de solidarité et de méfiance ; je nous imaginais comme les fêtards du bal du prince Prospero, qui allaient bientôt tomber comme des mouches. Sur le chemin du retour, je me suis enfin fait vacciner contre la grippe.

Le 13ème jour, mon téléphone a vibré au message WhatsApp d’Elliot, un homme rencontré quatre ans auparavant. À cette époque, nous avions eu deux rendez-vous, nous émerveillant de la série de coïncidences par lesquelles nous étions connectés — par exemple, nous étions tous deux citoyens d’Angleterre, d’Australie et des Etats-Unis, et alors qu’il était expert en résolution de conflits soudanais, ma grand-mère avait été le premier bébé blanc né à l’hôpital de Khartoum. Nous aurions certainement eu un troisième rendez-vous si je ne m’étais pas fracturé le cou dans un accident de voiture et si je n’avais pas été confiné dans un lit d’hôpital. Lorsque je lui ai envoyé un SMS cinq mois plus tard pour lui dire que j’étais enfin libéré de la minerve, il m’a annoncé qu’il avait déménagé en Jordanie.
Ce fut donc avec un certain enthousiasme que nous avions repris contact il y a quelques mois. Bien que nous ayons tous les deux des réserves l’un à l’égard de l’autre — je le trouvais trop exigeant et lui me trouvait de moeurs trop légères — j’ai néanmoins été déçue lorsqu’il est parti en Afrique pour un voyage d’affaires d’un mois. Mais ensuite, le virus a entamé sa montée exponentielle, le monde entier est entré en confinement, et maintenant il m’envoyait des SMS pour dire qu’il s’est mis en quarantaine dans une location temporaire à Melbourne, ayant réussi à s’échapper juste au moment où lui et ses collègues diplomates étaient exfiltrés de la région. Il essayait de voir le bon côté des choses, a-t-il dit, comme les bénéfices pour l’environnement ou les gens qui apprennent à être seuls à nouveau, bien qu’il ait également déploré — dans son exigence habituelle — qu’ils allaient maintenant passer tout leur temps sur les réseaux sociaux. J’ai dit que je doutais que les leçons sur l’environnement durent, malheureusement, ajoutant que je me débrouillais déjà bien dans la solitude. « Malgré tes fréquentations », a-t-il dit, une pique que j’ai laissé passer.
Notre dernière relation sexuelle avait quelque chose de l’épiphanie, a-t-il poursuivi, sûrement dû au fait qu’il avait déjà la tête en Afrique et pourtant il était retourné dans la chambre à coucher une fois que nous avions commencé à fantasmer sur ma venue chez lui à Nairobi. « C’était l’illustration la plus frappante de la partie psychologique du sexe que j’aie jamais eue », a t-il dit. Cette découverte ne m’a pas semblé remarquable du tout, mais je l’ai suivie, suggérant que nous partagions le même sorte de fantasme, enraciné dans la perspective d’une intimité et d’une connexion future. Puis il m’a envoyé huit dick picks d’affilée ; il n’était que 15h à Rhode Island, mais j’ai néanmoins monté les escaliers de ma chambre et fermé les stores aux ouvriers du bâtiment qui, semblaient-ils, étaient encore employés à la construction d’un nouveau conduit d’égout à l’extérieur de la maison. Je ne m’étais pas rasé les jambes depuis près d’un mois et mes sous-vêtements dataient du lycée et étaient pleins de trous, alors quand il m’a demandé un visuel, j’ai rapidement fouillé dans les archives, appuyant sur « envoyer » et attendant sa réaction. « C’est peut-être déplacé », a-t-il écrit à la place, « mais je préfère définitivement ton corps maintenant ». J’ai regardé à nouveau ce que je lui avais envoyé et j’ai commencé à rire – il s’agissait d’une capture d’écran horodatée qui montrait très clairement que c’était mes seins d’il y a quatre ans.
J’ai raconté cette histoire plus tard dans la journée, lors de mon tout premier « happy hour » Zoom, en riant maintenant de la perplexité d’Elliot lorsque je lui avais exprimé ma consternation de voir que les corps 1 et 2 étaient si radicalement différents. Malgré cela, j’ai dit aux visages sur mon écran d’ordinateur, qu’il était dommage que lui et moi ayons été si maudits par le sort, d’abord par une fracture du cou et ensuite par une pandémie mondiale ; malgré toute l’irritation qu’il a suscitée en moi, je ne pouvais pas m’empêcher de rêver de ce qui aurait pu être, à la façon dont nous aurions pu apprendre à nous pardonner nos défauts si le monde n’avait pas été bouleversé. Et je pense qu’il était d’accord avec moi : « C’est un peu dommage de ne pas avoir pu revenir », a-t-il dit avant que nous n’ayons fini d’écrire. « Ça ne m’aurait pas dérangé d’essayer de te faire sortir du marché. »
J’étais assise sur le pont pendant que je parlais, tenant Oscar sur mes genoux et prenant un plaisir inattendu à la vue de mes amis du lycée, qui en réalité étaient répartis d’une côte à l’autre des Etats-Unis. Helen était revenue de l’hôpital, Dieu merci, et était allongée sur son canapé à Brooklyn pendant que son mari faisait manger les enfants ; elle avait encore de la fièvre et une douleur aiguë dans les poumons, mais cet essoufflement terrifiant avait disparu quelques jours auparavant. Jessa était en confinement à Echo Park, où elle vit maintenant avec son nouveau petit ami — le chef privé d’un producteur de télévision qui avait rempli son allée de congélateurs et de réfrigérateurs industriels de location. Son patron n’avait pratiquement aucun scrupule, nous a-t-elle dit avec amertume, à l’envoyer dans sept épiceries différentes par jour à la recherche de kumquats et de lait d’avoine, alors que tout le reste de la Californie se réfugiait.
Rachel et son mari avaient passé leur isolement à microdoser des champignons et à vider leur maison de Pacific Palisades de tous les objets qui leur déplaisaient, y compris des chaises, des tables, des photos d’anciens amants, des cadeaux de la belle-famille et tous les journaux intimes que Rachel avait tenus. Ce dernier me remplissait d’inquiétude — je l’imaginais à 15 ans, remplissant cahier après cahier de sa belle écriture en boucles — et pourtant elle était catégorique ; elle disait qu’elle et Simon, en sanglotant, avaient déjà construit un énorme bûcher surplombant l’océan. Lorsque nous avons raccroché, tous les quatre, ils avaient prévu de procéder à une cérémonie d’incinération élaborée qui les débarrassait du passé et ouvrirait la voie à de nouveaux départs. Helen a demandé si elle pouvait nous montrer le bûcher, en portant son ordinateur à l’extérieur comme l’avait fait Jessa pour révéler les réfrigérateurs, mais Rachel a refusé. Non, a-t-elle dit, elle ne donnerait pas ce pouvoir à ces choses haineuses.
Avant de quitter le pont ce soir-là, j’ai envoyé texto à Daniel, une autre relique du passé et dont j’aurais pu tomber amoureuse s’il ne s’était pas illuminé lorsque je lui ai présenté par inadvertance le terme « non-monogame éthique » lors de notre premier rendez-vous — il était si heureux, a-t-il dit, d’avoir enfin trouvé les mots dont il avait besoin pour se définir. D’après Instagram, Daniel se cachait quelque part dans le sud-ouest américain avec ce qui semblait être une réserve à vie de haricots garbanzo ; il s’était lié d’amitié avec un lynx timide, et il y avait beaucoup de fleurs sauvages et de jolis petits oiseaux parmi les cactus. Il allait très bien, m’a-t-il dit quand je lui ai demandé, il était vraiment dans un bel endroit, et pourtant il a aussi admis qu’un peu de compagnie aurait été la bienvenue. « Nous devrions probablement nous envoyer des sextos ou autre chose », a-t-il dit. « Pour notre santé. »
« Pas de souci », ai-je dit. « Mais pour l’instant, je dois finir de préparer le dîner et regarder Homeland. » En signe de bonne volonté, je lui ai envoyé la même photo que j’avais envoyée à Elliot, en veillant à la recadrer correctement cette fois-ci.

Les jours continuaient à passer et il devenait de plus en plus difficile de les distinguer. Des amis appelaient et impossible de se souvenir si nous nous étions parlé il y a deux heures ou deux semaines. Le virus a tout teinté, donnant naissance à des émotions étrangères, brouillant les frontières entre le réel et l’imaginaire. J’ai ressenti une fureur aveugle lorsque notre Président a suggéré que les églises devaient être pleines pour Pâques, des pics d’anxiété lorsque les personnages du livre que je lisais sont entrés dans une salle bondée. Mes clients adolescents dormaient jusqu’à deux heures et fondaient en larmes lorsque je leur demandais s’ils avaient terminé quinze pages du livre L’oeil le plus bleu. Un garçon faisait des FaceTime alors qu’il errait dans les rues de Manhattan tel un flâneur encapuché, et la vue des avant-toits peints et du ciel bleu vif de ma ville, qui se balançait à chaque pas, m’a empli du mal du pays. Une autre cliente, une étudiante de première année, avait passé des jours à construire le plus splendide des forts dans sa chambre, accrochant au plafond toutes les serviettes et couvertures qu’elle pouvait trouver, dormant, mangeant et y donnant tous ses cours, jusqu’à ce qu’un matin, elle soit scandalisée par son désordre et qu’elle le démolisse. « Qu’est-ce que je fais de ma vie ? » se lamentait-elle. « Je ne peux pas construire des forts toute la journée ! » Ma mère avait commencé à écrire des courriels quotidiens qui étaient aussi de la littérature absurde — j’entendais dire que les chiens en Italie étaient très épuisés, demandait-elle, maintenant que leurs propriétaires les prêtent à tous leurs amis sans animaux et qu’ils font de l’exercice pendant des heures. Une autre fois, elle a envoyé une photo d’un cadeau qu’elle avait fait à sa sœur, une corde de marche de deux mètres de long avec des poignées à chaque extrémité. « Pourquoi est ce que tout le monde sur Internet fait du pain?” a demandé mon amie Nellie.
Le 20e jour, j’ai conduit Oscar chez un vétérinaire d’urgence que j’avais trouvé dans le Massachusetts. Les propriétaires d’animaux n’étaient plus autorisées à entrer dans la clinique ; à la place, il fallait appeler du parking et un technicien portant un masque et des gants en plastique récupérait votre animal sur le siège passager. En attendant, j’ai lu un récit de Ian sur la fatigue politique et le rétablissement — enfin, une de ses œuvres que j’avais sollicitée ! Ian et moi n’avions pas encore fait de FaceTime, principalement parce que j’étais trop paresseuse pour porter de vrais vêtements ou me maquiller, mais nous avions passé trois heures et demie au téléphone le vendredi précédent, où je l’avais trouvé charmant et attentionné. Il avait la voix profonde et claire d’une personnalité de la radio, et toutes les années qu’il avait passées à Trinity lui avaient donné les traces d’un accent irlandais. Depuis lors, j’ai réalisé qu’il était devenu la personne à qui je voulais confier des choses, la personne à qui je voulais envoyer des SMS quand j’étais triste. Puis Oscar m’est revenu tremblant, le ventre rasé, et j’ai passé le reste de la journée à essayer de faire une liste des raisons pour lesquelles ce serait bien s’il avait un cancer.
C’est ce même jour, je crois, que j’ai finalement mis fin à ma quarantaine pour William, un joueur de basket-ball universitaire devenu militant écologiste, que j’avais essayé de quitter à l’automne. Son obsession pour les sextos et les plastiques à usage unique, associée à son incapacité à me poser une seule question sur moi, m’avait donné envie de crier. J’ai fini par lui en dire et il a répondu en achetant mon livre sur Kindle, mais les choses se sont dégradées à partir de là. « Je suis juste confus », dit-il à propos de la préface, « parce qu’on dirait un genre d’écrit autobiographique ».
« C’est autobiographique », ai-je dit.
« Oh. » Il s’est tu pendant un moment. « Je suppose que j’ai juste pensé que d’après le titre – qui comprend les mots « Woolf » et « Virginia » – « tout serait à propos de Jane Eyre. »
Il est arrivé à la porte avec une bouteille de vin ; il estimait que la vie devait continuer face au virus, mais il m’a quand même fait plaisir en acceptant de s’asseoir dehors et à l’écart par un temps de trente degrés jusqu’à ce que la lumière quitte le ciel. Puis nous avons commandé une pizza, ouvert une autre bouteille de vin et nous nous sommes retirés aux extrémités opposées du canapé. Je lui ai parlé de mes craintes de devenir mère célibataire, et il a suggéré que nous devenions co-parents. J’ai essayé d’expliquer pourquoi je ne pouvais pas élever un enfant avec un homme indifférent à la Littérature, tout comme il ne pouvait pas élever un enfant avec une femme — moi en l’occurrence, comme je venais de le démontrer dans la cuisine — qui ne savait pas qu’on ne pouvait pas recycler le côté gras d’une boîte à pizza. J’ai été méchante avec lui, j’ai honte de le dire, en le punissant du fait que j’étais toute seule pendant une pandémie, qu’il n’était pas né complètement autre, que j’avais beau essayer, je n’arrivais à projeter dans aucun de ces hommes une âme sœur. La solitude, je n’arrêtais pas de penser, c’est les autres. Nous nous sommes disputés pendant un moment, puis nous avons commencé à baiser, me laissant avec un énorme sentiment de culpabilité d’avoir mis en danger toute l’humanité.
Cette nuit-là, j’ai rêvé de deux étrangers, dont l’un avait pelé la peau de l’autre et la portait comme un masque. Quand je me suis réveillée, j’ai réalisé que j’avais serré le poing dans mon sommeil — dans ma paume gauche se trouvait une rangée de petites demi-lunes ensanglantées, et William était parti.

Je suis seule depuis plus d’un mois au moment où j’écris ces lignes. Un à un, tous mes projets d’avenir ont été annulés, et il semble peu important que je sois en confinement jusqu’en mai ou novembre ou le mois de mai suivant. Comme pour mon accident de voiture, lorsque les préoccupations de ma « vraie vie » ont été annulées en un instant, je me retrouve dans une sorte de présent continu, avec la particularité que cette fois-ci, presque tous les habitants de la planète sont dans le même bateau. Il y a des matins où je me réveille avec la lumière du soleil qui filtre à travers les planches de bois et où je me sens presque heureuse ; ce n’est que lorsque je regarde les gros titres qui se sont empilés comme des corps pendant la nuit que la catastrophe revient.
Chaque jour, je parle à mes amis dans tout le pays et dans le monde entier, recueillant leurs propres récits de quarantaine — le virus a envahi la vie humaine comme il envahit le corps humain, semble-t-il, en s’accrochant et en faisant des ravages. Il y a Samantha, une survivante du cancer qui va bientôt avoir un bébé avec une mère porteuse ; la mère porteuse vit dans l’Ohio, et Samantha vient d’apprendre qu’elle et son mari ne seront pas autorisés à entrer dans la salle d’accouchement. Il y a Eliza, une mère qui travaille et qui est en plein divorce acrimonieux, dont le mari vient de rentrer à la maison pour garder les enfants à plein temps. Il y a Sean, qui a récemment eu un bébé d’un coup d’un soir et qui est ensuite allé en quarantaine dans l’enceinte familiale de la mère, dans la banlieue de Buenos Aires ; pendant des mois, il a juré que lui et elle n’étaient qu’amis, mais maintenant ils boivent du vin dans les champs de maïs et tombent de plus en plus amoureux. Il y a Dom, l’ami de Sean, qui a invité une fille qu’il connaissait à peine à le rejoindre pour un week-end à Séville et qui se retrouve maintenant domestiqué et attaché, et Bethany, une autre mère célibataire qui craint de devenir violente avec ses enfants – « Non, vraiment, dit-elle lorsque je proteste, ils me fuient quand je me contente de les regarder ».
Il y a mon oncle Robert, un célibataire anglais dont la planche de salut était le pub du quartier et qui vient de doubler sa dose d’antidépresseurs, et Laura, une dermatologue qui apprend pour la première fois à intuber un patient, et Eva, qui a décidé d’attendre que la situation s’améliore seule au Costa Rica et vient d’adopter un nouveau chiot. Il sera intéressant de voir — Sean et moi étions d’accord, lui dans ses champs de maïs argentins, moi au bord de mon fleuve – comment cette contagion nous rassemblera et nous déchirera. , « Pense seulement à tous les nouveaux divorcés qui vont bientôt inonder le marché » a dit mon ami célibataire David alors que nous cherchions des bons côtés.
Aidez-nous à vous raconter le monde
Frictions lance son club : en soutenant Frictions, vous faites vivre une communauté d’auteurs et de journalistes qui racontent le monde par l’intime !

Je n’ai pas eu de nouvelles de Paul ou de Steven depuis des semaines, ni d’Elliot, de Daniel ou de William — peut-être ont-ils réalisé, comme moi, après notre première vague de communication, qu’il est en fait plus solitaire de saisir un simulacre d’intimité que d’essayer de faire la paix avec sa solitude. Dans les années qui ont suivi mon divorce — une rupture qui a clarifié à quel point je m’étais perdue dans le mariage — j’ai lutté entre le désir de reconstruire mon identité et le désir de me dissoudre dans un autre être humain. Jamais cette tension n’a été plus aiguë que pendant cette période d’isolement, alors que certains jours la douleur de la solitude est comme une blessure ouverte, et d’autres jours je me réjouis de ma propre autonomie, en la serrant contre moi comme un compagnon en chair et en os. J’ai continué à m’appuyer sur ma mère et mes amis, passant beaucoup plus d’heures au téléphone qu’auparavant ; en même temps, je suis devenue presque cupide de mon isolement, annulant souvent les rendez-vous de Zoom à la dernière minute simplement pour que mes chats et moi puissions nous asseoir dehors et regarder l’eau. (L’échographie d’Oscar a montré que tout était normal, bien que le mystère de sa baisse de santé continue). Hier, ma mère m’a envoyé une photo d’un pain de courgettes qu’elle avait préparé – « Oh, j’aimerais être là pour te faire la cuisine », m’a-t-elle dit, et j’ai paniqué rien qu’en y pensant. Et pourtant, je parle toujours à Ian à Hong Kong. Parfois, nous nous retrouvons pour un FaceTime le matin ou le soir, et je me trouve apaisée par son visage fort et sa voix de présentateur radio. Peut-être pourra-t-il rentrer chez lui un jour et je recommencerai ce processus de dissolution en quelqu’un d’autre, ou peut-être nous aimons-nous seulement parce que nous ne nous sommes jamais rencontrés.
Il y a peu de temps, j’ai parlé à Jon, le seul homme à part mon ex-mari que j’ai jamais aimé. Lui et sa petite amie se sont terrés à Chicago avec sa mère, et chaque week-end, ils se rendent en voiture à la maison de la mère sur le lac Michigan et marchent sur le sable. Il s’est inquiété, a-t-il plaisanté, en pensant à ma propension à la solitude, qu’ils allaient me perdre à cause de cette pandémie — que je deviendrais si amoureuse de mon propre acte de disparition que personne ne me reverrait plus jamais. Pendant qu’il parlait, j’observais un homme aux cheveux blancs dans un canot blanc ; chaque après-midi en été, il ramait vers son voilier au milieu du bassin, mais maintenant que c’était l’hiver et que tous les amarres étaient vides, il ramait simplement vers le Sud. Je me demandais où il allait. Il se déplaçait avec le courant – même s’il avait posé ses rames, il aurait fait de bons progrès – et une fois qu’il avait passé le vieux pont de pierre, le fleuve s’élargissait et il n’y avait plus d’endroit où se poser. Ne t’inquiète pas, j’ai dit à Jon, je ne vais nulle part.